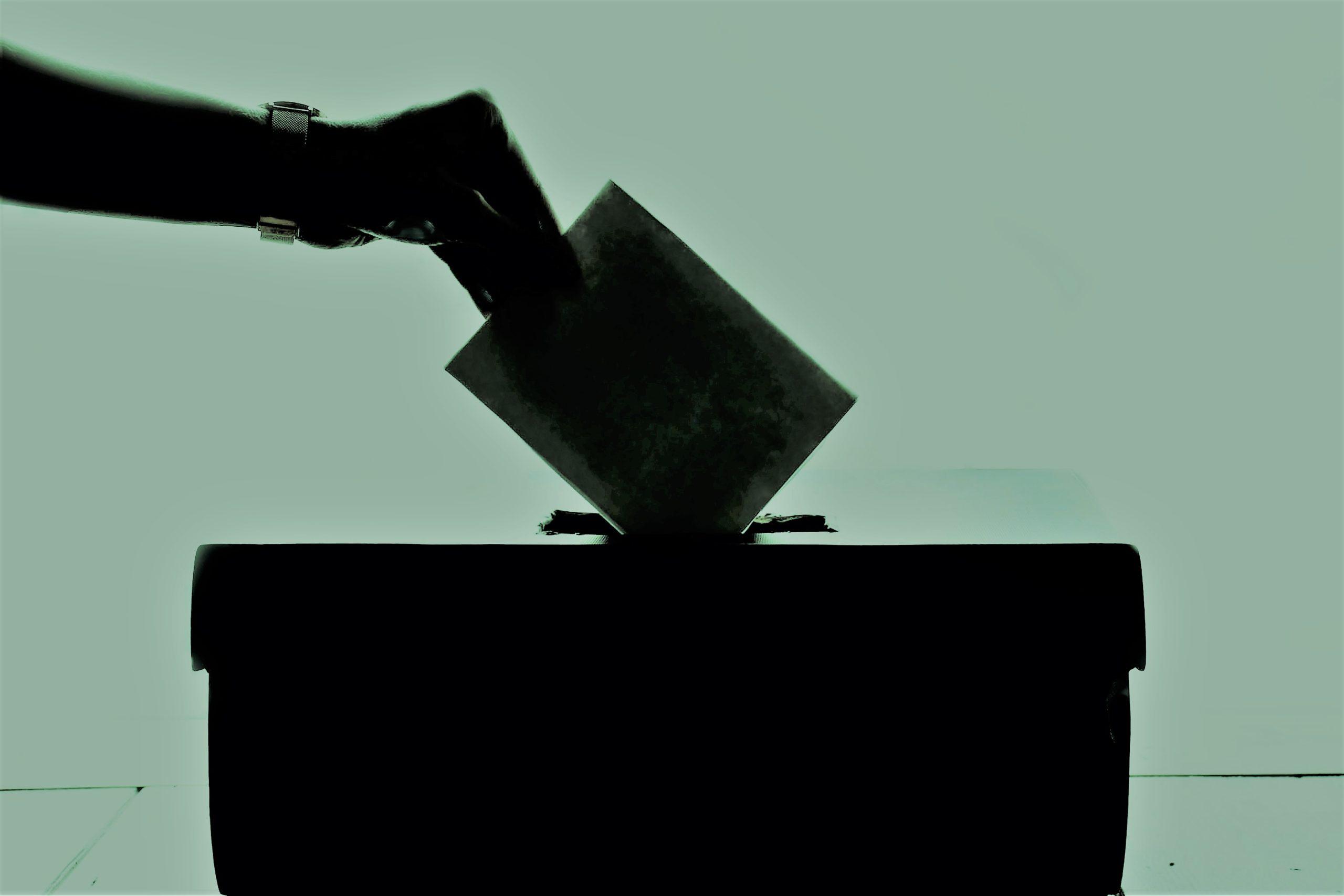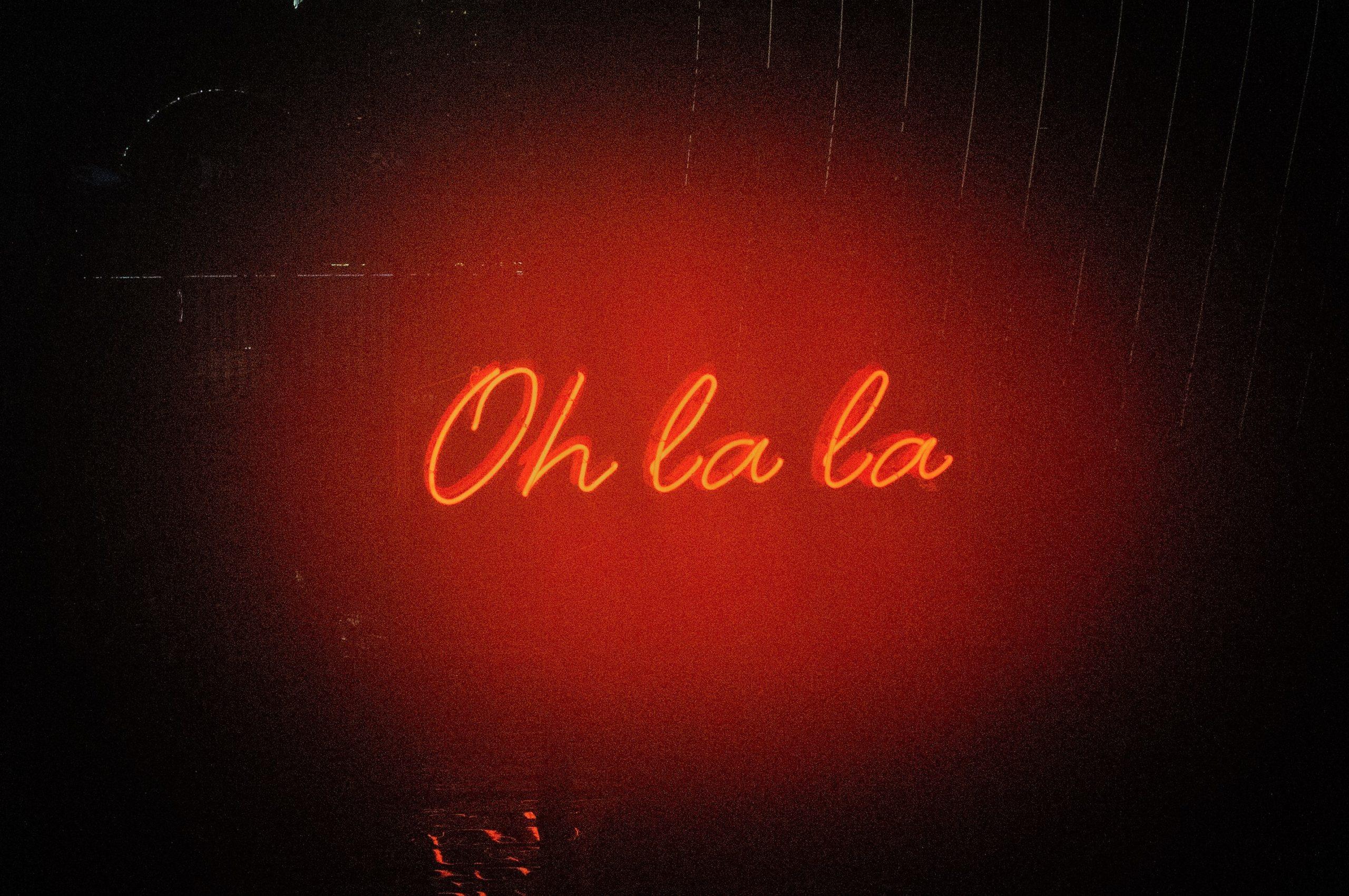[Résumé]
Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise, en matière de droit des sociétés, qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.
(Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-21.860, Publié au bulletin)
[Rappel des faits et de la procédure]
En l’espèce, un dirigeant majoritaire ainsi que son épouse envisagent de céder l’intégralité des parts sociales qu’ils détiennent dans le capital de la société à responsabilité limité au profit d’un cessionnaire unique. Une promesse de cession est signée sous certaines conditions suspensives.
Avant la réitération de la vente des parts, les cédants convoquent et tiennent deux assemblées générales aux termes desquelles deux primes conséquentes sont consenties au cédant dirigeant majoritaire. L’une correspond à sa fonction de mandataire social, l’autre à un simple rappel de salaire.
Postérieurement à la réitération de la vente des parts, le cessionnaire refuse de verser les primes au cédant au motif qu’elles caractériseraient des actes anormaux de gestion mettant en péril les intérêts de la société.
C’est dans ces conditions que le cédant bénéficiaire des primes saisi le tribunal de commerce de Bourges aux fins de paiement desdites primes. En défense, le cessionnaire demande l’annulation des résolutions prises en assemblées générales sur le fondement de l’abus de majorité. Les juges de première instance considèrent, d’une part, qu’il n’y a pas eu abus de majorité au motif que « les décisions [ont] été prises en adéquation avec la situation financière de la société et à l’unanimité lors des assemblées générales » et, d’autre part, que le formalisme prévu aux statuts a parfaitement été respecté. Ils rejettent donc l’argument du cessionnaire et condamnent la société au paiement des primes.
Le cessionnaire interjette appel. Par un arrêt du 14 juin 2018, la Cour d’appel de Bourges infirme la décision de première instance, annule les délibérations adoptées lors des deux assemblées générales et juge que les primes constituaient une rémunération abusive car manifestement excessive et contraire à l’intérêt social.
Le cédant forme un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 13 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure les juges du fond en ces termes : « en statuant ainsi, sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l’intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cette décision est prise au visa, notamment, de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises aux termes duquel une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.
[L’avis du Cabinet]
Cette décision parait conforme à l’orthodoxie juridique. En effet, il semble que le cessionnaire ait été négligeant dans l’opération d’acquisition qui précisait justement l’existence de cette prime. A court d’argument, le cessionnaire a sans doute tenté le tout pour le tout postérieurement à l’opération mais cette action était vouée à l’échec. Peut-être la mise en œuvre de la clause de garantie d’actif passif aurait-elle été plus efficace…
Le nouvel article L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil. »