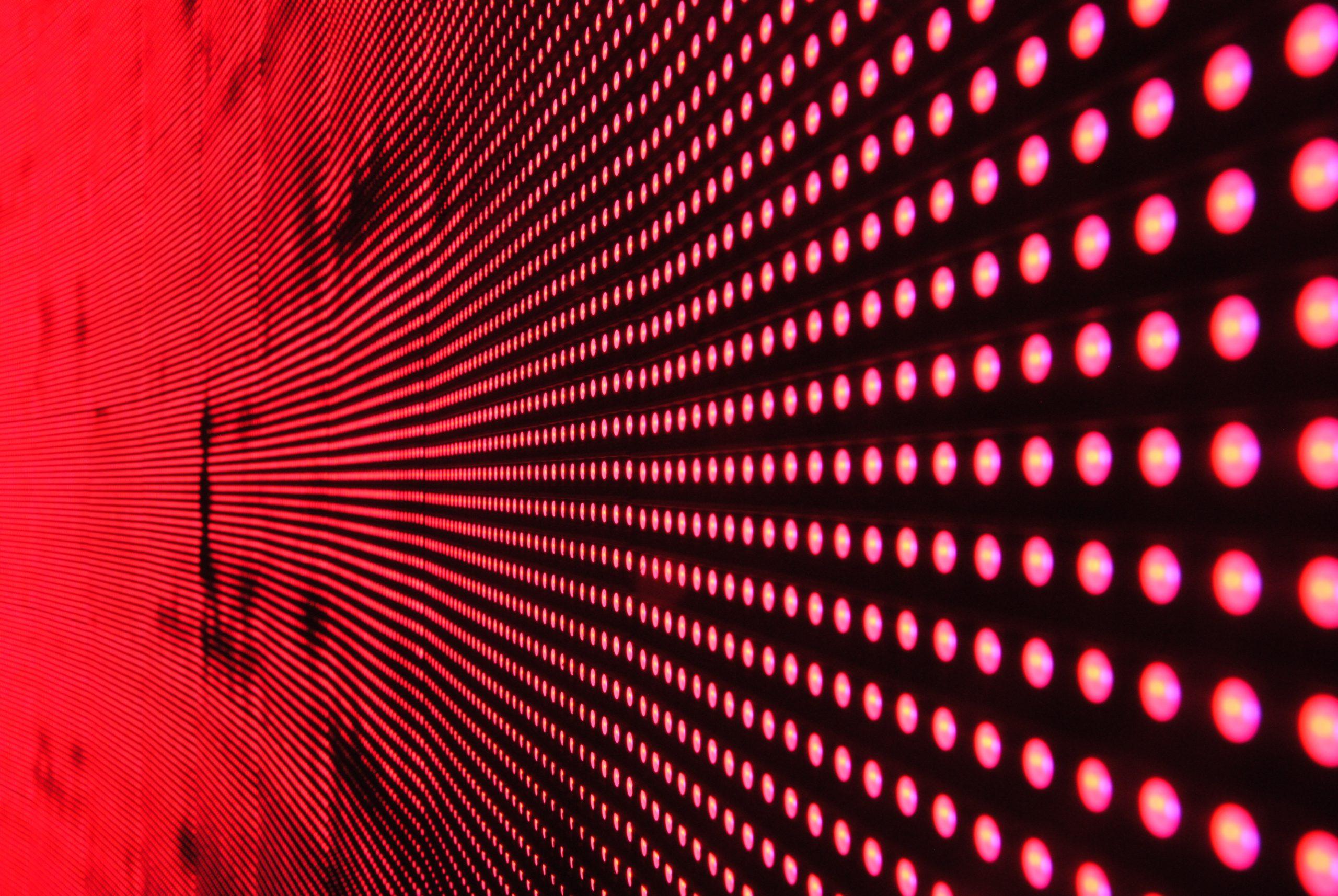Le 9 février 2013, à la suite d’un démarchage, un acquéreur personne physique conclut un contrat de vente portant sur des panneaux photovoltaïques avec une société, exerçant sous le nom commercial de « Groupe solaire de France » (le vendeur).
Aux fins de cette installation, l’acquéreur et son épouse contractent un crédit avec la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
Le 12 janvier 2014, le vendeur est placé en liquidation judiciaire.
Les 6 et 11 février 2015, les époux emprunteurs assignent le liquidateur ainsi que la banque en formulation de plusieurs demandes :
– d’une part, à l’égard du liquidateur, le couple exige la résolution du contrat pour inexécution et l’annulation du contrat de vente.
– d’autre part, à l’encontre de la banque, il réclame la suspension ainsi que l’annulation du contrat de crédit, la restitution des sommes versées, de même que des dommages et intérêts.
Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris le 21 février 2019, laquelle déclare les époux irrecevables à agir :
– tant contre le liquidateur du vendeur en application de l’article 122 du Code de procédure civile,
– que contre la banque en application de l’article L. 311-32 du Code de la consommation.
Le couple forme un pourvoi en cassation.
Ce dernier se prévaut de l’article L. 622-21 du Code de commerce qui dispose :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
A cet égard, les demandeurs font un rappel de leurs prétentions :
– à titre principal : la nullité, fondée sur la violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
– à titre subsidiaire : la résolution du contrat, fondée sur la violation de l’obligation de faire du vendeur.
Or, ils soulignent qu’en tout état de cause, la disposition précitée n’empêche pas une action en nullité ou résolution pour inexécution.
Le 7 octobre 2020, la Chambre commerciale de la Haute juridiction donne raison aux époux et casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu’en effet, l’article L. 622-21, I du Code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice, à compter du jugement d’ouverture de la part ces créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par voie de conséquence, elle déduit que les demandes formulées ne contredisaient pas la suspension des poursuites imposée par l’article précité, puisqu’en toute hypothèse, aucune ne tendait à la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour non-paiement de cette dernière.
Telle est la faille du principe de suspension des poursuites posé par l’article L. 622-17, constituant pourtant l’un des points cardinaux de la protection accordée au débiteur en procédure collective, la demande n’est pas toujours pécuniaire.
Il s’agit désormais pour tous les co-contractants, de choisir soigneusement leur débiteur ; pour préférer le débiteur « prestataire », tenu à la fourniture d’un bien ou d’un service, au redevable d’une somme d’argent par quelque moyen que ce soit.
(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.422, Publié au bulletin)