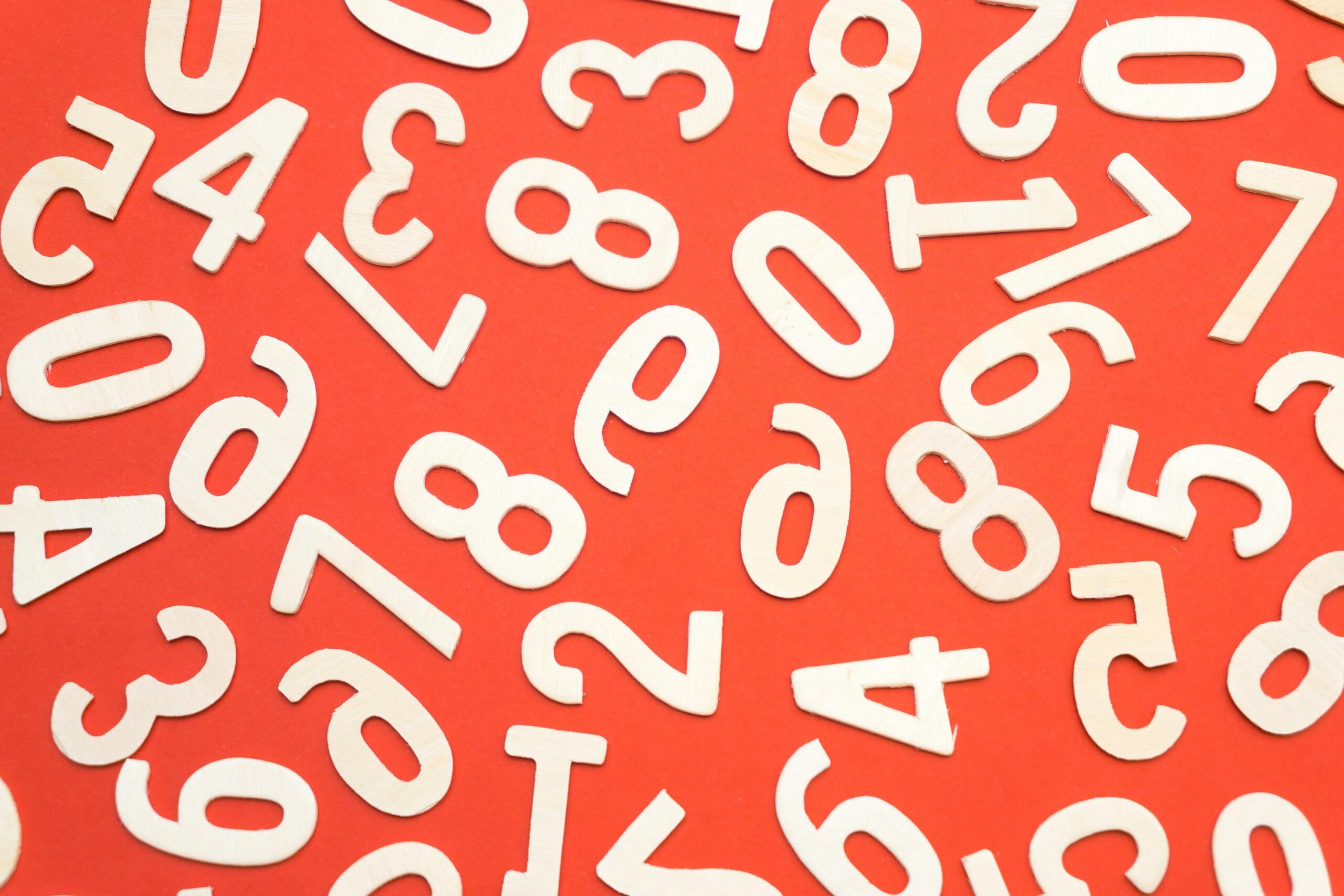Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux
Introduction
Le compte courant d’associé constitue un instrument central du financement des sociétés, situé à la frontière du droit des obligations et du droit des sociétés. Mécanisme souple, fréquemment utilisé dans la pratique, il n’en demeure pas moins juridiquement encadré et source d’un contentieux nourri, tant en période normale qu’en contexte de difficultés de l’entreprise. L’étude de son régime juridique révèle une construction essentiellement prétorienne, adossée à des textes épars, et structurée autour de problématiques récurrentes : qualification juridique, conditions de remboursement, opposabilité des clauses de blocage, articulation avec les procédures collectives et responsabilité des dirigeants.

1. Le cadre juridique du compte courant d’associé
1.1. La définition et la nature juridique du compte courant d’associé
Le compte courant d’associé correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé en dehors de tout apport au capital. Il génère une créance personnelle de l’associé contre la société, juridiquement distincte de ses droits sociaux.
La jurisprudence rappelle de manière constante que les avances en compte courant ne constituent pas des apports, mais des dettes sociales venant augmenter le passif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé qu’une répartition des parts sociales fondée sur les montants investis en compte courant procède d’une confusion entre capital social et créance, juridiquement infondée (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/13667).
Cette qualification emporte des conséquences majeures, tant sur la valeur des droits sociaux que sur le régime du remboursement, lequel obéit au droit commun des obligations, sous réserve des règles spéciales du droit des sociétés.
1.2. L’encadrement légal selon la forme sociale
1.2.1. Les sociétés commerciales
Le Code de commerce n’organise pas un régime général du compte courant d’associé, mais pose certaines interdictions et mécanismes de contrôle.
L’article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n’interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur.
Par ailleurs, l’article L. 223-19 du Code de commerce soumet les conventions de compte courant au régime des conventions réglementées, imposant leur information et leur approbation par les associés, sans que le défaut d’approbation n’entraîne nécessairement leur nullité.
1.2.2. Les sociétés civiles et structures spécifiques
Dans les sociétés civiles, l’obligation annuelle de reddition de comptes prévue à l’article 1856 du Code civil inclut nécessairement l’information sur les mouvements des comptes courants d’associés.
Certaines structures font l’objet d’un encadrement renforcé. Tel est le cas des sociétés d’économie mixte locales, pour lesquelles l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, limitant strictement la durée et les modalités des avances en compte courant.
2. Le remboursement du compte courant d’associé : principe et tempéraments
2.1. Le principe de la libre exigibilité
La jurisprudence affirme de manière constante que, sauf stipulation contraire, le compte courant d’associé est remboursable à vue. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que l’exigibilité immédiate constitue la caractéristique essentielle du compte courant, distincte de l’intangibilité du capital social (CA Toulouse, 19 décembre 2001, n° 2001/00921).
Ce principe confère à l’associé la qualité de créancier chirographaire ordinaire, pouvant réclamer le remboursement indépendamment de la situation financière de la société, en période normale.
2.2. Les limites conventionnelles et statutaires au remboursement
La liberté contractuelle permet d’aménager les modalités de remboursement par des clauses de blocage, de préavis ou de terme. La Cour d’appel de Paris admet ainsi la validité de clauses statutaires interdisant le remboursement avant une certaine date, y compris lorsque l’associé a perdu sa qualité, dès lors que ces clauses sont claires et acceptées (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837).
En revanche, la jurisprudence sanctionne les clauses qui subordonnent le remboursement au seul bon vouloir du gérant ou de la société. Une telle stipulation est qualifiée de condition purement potestative et déclarée nulle, conformément à l’ancien article 1174 du Code civil, aujourd’hui repris à l’article 1304-2 (CA Amiens, 21 septembre 2010, n° 08/01576).
2.3. Compte courant et changement de la qualité d’associé
La cession de parts sociales n’emporte ni cession automatique ni abandon du solde créditeur du compte courant. La jurisprudence exige une stipulation expresse en ce sens. À défaut, l’ancien associé conserve sa créance et peut en demander le remboursement à tout moment (TJ Nanterre, 11 octobre 2024, n° 22/06011, se référant notamment à Com. 11 janvier 2017, n° 15-14.064).
3. Les risques contentieux liés au remboursement du compte courant
3.1. Le remboursement en période normale : résistance abusive et nullité des clauses
Le refus injustifié de remboursement, en l’absence de convention de blocage valable, est susceptible de constituer une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts (CA Toulouse, 19 septembre 2018, n° 16/06056).
Inversement, l’associé ne saurait se prévaloir d’un remboursement immédiat lorsque des stipulations statutaires ou conventionnelles valablement opposables en organisent l’échelonnement.
3.2. Le remboursement en période de difficultés et de procédures collectives
3.2.1. L’interdiction des paiements préférentiels
En période de cessation des paiements, le remboursement d’un compte courant d’associé constitue le paiement d’une dette échue. Il peut toutefois être annulé sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce si l’associé bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
La Cour d’appel de Douai rappelle que le droit au remboursement n’est pas absolu et doit céder devant le principe d’égalité des créanciers (CA Douai, 7 juillet 2022, n° 21/04209).
La connaissance de la cessation des paiements s’apprécie in concreto. La Cour de cassation a jugé qu’elle ne se présume pas de la seule qualité de dirigeant, mais doit être personnellement caractérisée (Com. 19 novembre 2013, n° 12-25.925, publié au Bulletin).
3.2.2. La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion
Le dirigeant qui procède au remboursement de comptes courants alors que la société est en cessation des paiements s’expose à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a validé la condamnation d’un dirigeant ayant effectué de tels remboursements en connaissance de cause, en retenant une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif (Com. 24 mai 2018, n° 17-10.119).
La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette sévérité, notamment lorsque les remboursements ont privé la société de toute trésorerie au détriment des autres créanciers (CA Paris, 7 avril 2022, n° 21/09772 ; CA Amiens, 7 mars 2024, n° 23/02251).
Conclusion
Le compte courant d’associé apparaît comme un outil de financement efficace mais juridiquement exigeant. Créance personnelle, en principe remboursable à tout moment, il demeure soumis à des limites statutaires, conventionnelles et légales dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences lourdes, tant pour l’associé que pour le dirigeant. La jurisprudence, particulièrement vigilante en période de difficultés, rappelle que la souplesse du mécanisme ne saurait justifier des atteintes à l’égalité des créanciers ni des comportements assimilables à des fautes de gestion. La sécurisation du compte courant d’associé impose ainsi une rédaction rigoureuse des statuts et conventions, ainsi qu’une vigilance accrue dans la gestion de la trésorerie sociale.